

La femme noire n’est le porte-étendard ni du combat antiraciste ni de la lutte pour l’émancipation des femmes ; elle est plutôt considérée, dans l’un comme dans l’autre, comme une sous-question.
Dans une salle de réunion, quelque part dans un immeuble de bureaux, des collègues défendent vigoureusement leurs idées. Ils font de leur mieux pour briller devant le patron. Certains font bonne impression à tout coup. Mais il y a quelqu’un dans l’équipe, quoique tout aussi pertinent et volubile, qui ne parvient pas à se faire remarquer.
Dans les situations où se côtoient des hommes et des femmes, des Noirs et des Blancs, cette personne qui passe inaperçue, c’est souvent la même : la femme noire.
C’est du moins la conclusion qu’on peut tirer d’une expérience menée par deux chercheuses américaines en psychologie sociale.
Elles ont fait écouter à leurs sujets (presque tous Blancs) une conversation entre huit personnes – deux femmes noires, deux femmes blanches, deux hommes noirs et deux hommes blancs – où chacun disposait du même temps de parole. Par la suite, les cobayes devaient lire les énoncés prononcés pendant la discussion et tenter de se rappeler qui avait dit quoi.
Les interventions des femmes noires étaient moins bien gravées dans leur mémoire que celles de tout autre groupe. Les gens confondaient plus souvent les interlocutrices noires l’une avec l’autre, et ils attribuaient plus souvent leurs propos à leurs camarades.
Dans un autre volet de l’étude, les sujets ont d’abord regardé une série de photos de visages et ont tâché de les mémoriser. Ensuite, ils ont tenté de repérer, parmi une nouvelle collection de visages, ceux qu’ils avaient déjà vus. Encore une fois, de tous les groupes, ce sont les femmes noires qu’ils ont eu le plus de difficulté à reconnaître. Dans l’esprit des cobayes, elles étaient particulièrement oubliables.
Les spécialistes considèrent l’invisibilité comme une des manifestations de la discrimination. Des professeures et employées noires l’ont identifiée comme un thème récurrent de leur expérience sur un campus universitaire où elles sont en minorité, par exemple. On peut supposer qu’une version de ce scénario se produit dans les entrevues d’embauche, les cocktails de réseautage, les concours, les campagnes électorales, dans tous ces contextes où notre destinée dépend de notre capacité à nous faire voir et entendre, à marquer les esprits.
Qu’arrive-t-il quand il faut élever la voix pour défendre ses droits, crier haut et fort pour réclamer justice ? Là aussi, les femmes noires sont trop souvent repoussées à la marge.
On le constate dans le cadre de la mobilisation contre le racisme et la violence policière qui ébranle l’Amérique.
On n’oubliera pas de sitôt le nom de George Floyd, devenu dans la mort le catalyseur du soulèvement. Mais celui de Breonna Taylor — tuée quelques semaines avant lui par un policier à Louisville, au Kentucky — ne s’est pas inscrit aussi profondément dans la psyché collective. De façon générale, la mort d’hommes afro-américains aux mains de la police a provoqué de plus grandes vagues d’indignation que celle de femmes ayant subi le même sort.
C’est comme si la femme noire échappait à notre catégorisation grossière du monde. Dans l’esprit de la majorité, la femme noire serait moins représentative de l’ensemble des Noirs qu’un homme noir, et moins représentative de l’ensemble des femmes qu’une femme blanche. De la même manière, l’archétype de la victime de négrophobie, c’est plutôt un homme noir qui l’incarne. Si on pense à qui subit du sexisme dans notre société, c’est d’emblée une femme blanche qui est imaginée.
La femme noire, elle, n’est le porte-étendard ni du combat anti-raciste, ni de la lutte pour l’émancipation des femmes ; elle est plutôt considérée, dans l’un comme dans l’autre, comme une sous-question, une exception, voire une distraction. Doublement atypique, doublement marginalisée, elle tombe entre les mailles du filet.
Au début du mois, des activistes ont lancé une opération médiatique pour sortir Breonna Taylor de l’invisibilité. Une autre initiative, « SayHerName », est née en 2015 pour inciter le public à commémorer les victimes féminines de violence policière au même titre que les victimes masculines. Plus largement, la campagne milite pour que le mouvement pour la justice raciale, qui a été propulsé par le travail des femmes noires, leur donne davantage la parole et tienne mieux compte de leurs expériences.
Car des données confirment que la brutalité policière et le profilage racial, tant au Québec qu’ailleurs en Amérique du Nord, ce ne sont pas que l’affaire des hommes.
Aux États-Unis, par exemple, selon une récente étude des interactions fatales avec la police, les femmes afro-américaines sont plus susceptibles que tout autre groupe d’avoir été abattues alors qu’elles n’avaient pas d’arme sur elles.
À Montréal, selon un rapport sur le profilage racial au SPVM, les femmes noires sont deux fois plus à risque d’être interpellées par les policiers que les femmes blanches. À Halifax, c’est 3,6 fois plus. À Ottawa, celles qui prennent le volant s’exposent à un risque disproportionné d’être interceptées par la police : les conductrices noires de 16 à 24 ans, notamment, subissent un taux de contrôle routier 80 % plus élevé que ne le laisserait présager leur représentation au sein de la population.
Le racisme institutionnel prend aussi envers elles des formes particulières, que ne saurait couvrir une approche de type « one size fits all ». Pour une femme noire, le profilage racial, ça peut vouloir dire de se faire prendre pour une prostituée. La violence policière, ça peut inclure des membres fracturés mais aussi des agressions sexuelles. Les accrochages avec les autorités, ça comprend les démêlés avec le système de protection de la jeunesse : des recherches ont notamment montré qu’à Montréal, les enfants noirs sont deux fois plus susceptibles que les autres jeunes de faire l’objet d’un signalement à la DPJ, mais qu’après évaluation, ils requièrent finalement moins de services que ceux des autres groupes.
Si on néglige la dimension genrée du racisme, si on omet de s’intéresser aux différents visages qu’il adopte selon qu’il cible des femmes ou des hommes, on passe à côté de la moitié du problème, et de la moitié des solutions.
L’effacement des femmes noires, ce n’est pas seulement le défaut du mouvement anti-raciste. Le mouvement féministe aussi participe à leur invisibilité. Au Québec comme ailleurs, par souci de parler d’une seule voix, le féminisme mainstream a laissé croître des angles morts béants. Il a eu du mal à intégrer – dans son discours, ses revendications, ses actions – le fait que les gains pour la majorité ne se traduisent pas forcément en avancées pour les minorités.
Au Canada, les femmes blanches n’ont toujours pas rejoint l’autre sexe au chapitre des revenus d’emploi : elles gagnent 67 sous pour chaque dollar que les hommes blancs récoltent. Les femmes noires, elles, sont encore plus loin derrière : leurs revenus correspondent à seulement 56 % de ceux des hommes blancs. De fait, les femmes blanches gagnent bien mieux leur vie que les femmes noires, et même légèrement mieux que les hommes noirs, selon les données compilées par le Centre canadien de politiques alternatives. En outre, environ deux fois plus de femmes noires (25 % d’entre elles) que de Blanches (13 %) vivent sous le seuil de la pauvreté.
On voit bien que toute considération du déséquilibre entre les sexes est incomplète si on écarte les inégalités entre différentes catégories de femmes. Mais un certain nombre de féministes craignent que l’enjeu racial noie leurs revendications, ou encore qu’il creuse des fossés entre les femmes alors qu’elles auraient avantage à se souder. Or, comme l’écrivent Naïma Hamrouni et Chantal Maillé dans le livre Le sujet du féminisme est-il blanc ?, « ne plus parler de racisation, et particulièrement de “femmes racisées”, loin de contrer la réalité du racisme à laquelle ces termes renvoient, risquerait au contraire de la masquer, et d’autoriser sa reproduction sournoise ». On ne peut pas réparer ce qu’on se refuse à nommer ou à voir.
Même les institutions chargées de remédier aux disparités économiques entre les sexes passent sous silence l’écart qui sépare les femmes racisées de leurs consœurs. Dans son plus récent bilan de la Loi sur l’équité salariale, par exemple, le ministre du Travail réserve un grand total de trois phrases à la « situation des travailleuses immigrantes ou des membres de minorités visibles », reléguées dans l’avant-dernière section d’un document de 120 pages.
C’est paradoxal mais, ayant évolué toute ma vie dans des espaces où j’étais l’une des très rares, voire la seule personne issue d’une minorité visible – que ce soit à l’école, au travail ou dans mes cercles d’amis –, j’ai souvent trouvé moins compliqué de ne pas m’étendre sur cette part de mon identité. Ainsi, dans mes écrits sur les inégalités entre les femmes et les hommes, je n’ai pas toujours suffisamment intégré la perspective des femmes racisées. Lors des événements devant public que j’ai animés sur le sujet, j’ai parfois laissé aux quelques femmes racisées dans l’assistance l’odieux de lever la main et de soulever elles-mêmes la question, au lieu d’utiliser ma tribune pour donner une voix à leurs expériences. Moi aussi, j’ai traité cet enjeu comme une parenthèse qu’on pouvait sauter, pour faire court. Je le regrette, et je ferai mieux désormais.
Faut-il déployer des efforts particuliers pour tenir compte d’un groupe qui ne représente, somme toute, qu’une fraction de la population (à Montréal, 31 % des femmes appartiennent à une minorité visible, dont 9 % sont noires) ? J’en suis venue à penser que c’est essentiel. Pour reprendre les mots de la militante afro-américaine Angela Davis, « quand les femmes noires font des gains, c’est un plus pour pratiquement tous les segments de la société ». Car en général, lorsqu’on se soucie des plus vulnérables, on pare du même coup à toutes les vulnérabilités, y compris celles des femmes majoritaires. L’inverse n’est pas nécessairement vrai.
Noémi Mercier





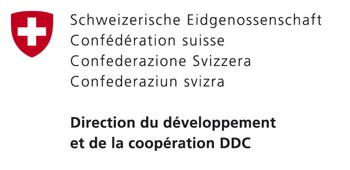

Programme Genre et Développement
S/C IPD-AOS
01 BP 1756 Ouagadougou 01
Tél.: (226) 70440372 / 76209811
E-mail: gender.africa@gmail.com
Copyright © 2022 Programme Genre - Tous droits réservés. Conception: Yam-pukri


